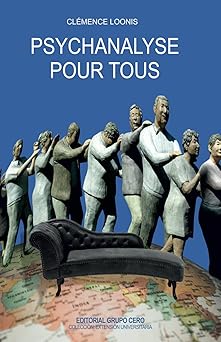
La dépendance affective : une lecture psychanalytique
Comprendre les fondements inconscients de cette première dépendance est essentiel pour saisir les dynamiques affectives et sociales ultérieures de l’être humain.
Le nouveau-né naît au sein d’un environnement familial qui, sur certains plans, relève encore de notre héritage animal. Si personne n’assume la fonction maternelle — c’est-à-dire ne répond à ses besoins physiologiques, biologiques, émotionnels — l’enfant ne survit pas.
Cette relation première, absolument vitale, laisse une empreinte psychique durable : le lien affectif. Elle est à l’origine des émotions humaines et structure le rapport du sujet au monde et aux autres.
Pourquoi cette relation est-elle si fondamentale ? Parce qu’elle ne nous donne pas seulement la vie : elle nous la sauve. Et c’est pour cela que nous attribuons à la mère un pouvoir qu’elle n’a pas en réalité : elle peut ce que je ne peux pas.
L’impuissance du nourrisson
À sa naissance, le bébé est dans une impuissance totale — non psychologique, mais organique : il ne peut ni marcher, ni voir clairement, ni réguler sa respiration, ni atteindre de lui-même la nourriture. Il dépend donc entièrement d’un autre être humain pour survivre. C’est ce qui fonde le lien de dépendance. Celui ou celle qui assume cette fonction — généralement la mère — acquiert un prestige immense à ses yeux : elle détient ce qui me sauve.
La cellule narcissique
C’est dans ce contexte qu’apparaît un concept essentiel : celui de cellule narcissique. Il désigne l’union fusionnelle entre la mère et l’enfant, nécessaire à sa survie et à son humanisation. Dans cette union, l’enfant ne se pense pas séparé d’elle : il n’a pas encore de désir propre, ne parle pas, ne pense pas. Il ne répond qu’à des stimulations organiques — faim, soif, chaleur, froid — perçues comme des demandes.
La mère, en retour, le perçoit souvent comme une prolongation d’elle-même, et agit comme le miroir dans lequel l’enfant se forme.
Le passage de la nécessité au désir
Cette première expérience de satisfaction — par exemple, lorsque le lait chaud apaise la faim — marque profondément le sujet. Il cherchera toute sa vie à retrouver cette expérience fondatrice de plaisir, non pas tant pour la satisfaction elle-même, mais pour la répétition du plaisir perdu, qui n’existe plus.
Ainsi naît le désir : non plus besoin physiologique, mais mouvement vers une répétition impossible. L’enfant apprend à désirer, à chercher sans jamais pouvoir retrouver l’objet de son premier apaisement. Le désir devient moteur, même s’il ne satisfait jamais totalement.
L’influence des émotions maternelles
Au début, la mère et l’enfant ne forment qu’un. L’enfant ne possède pas ses propres émotions : il vit les émotions que la mère ressent et lui transmet. Si la mère est malade, l’enfant tombe malade ; si elle est triste, il cesse de manger ; si elle est anxieuse, il pleure sans cesse. Cette cellule narcissique est essentielle à la construction de l’enfant.
La dépendance à l’âge adulte
Cette première relation à la mère devient souvent le modèle inconscient de toutes les relations ultérieures. Certains adultes, marqués par cette expérience, recherchent cette mère idéale dans leurs partenaires amoureux, sans jamais réussir à rompre avec cette figure primitive. La dépendance affective apparaît alors comme une forme de soumission, un refus de renoncer à cette complétude originaire.
Se libérer de la dépendance affective
Comment sortir de cette dépendance ? En se psychanalysant.
Car il existe une autre forme de dépendance : celle qui accepte que, pour vivre, nous avons besoin des autres. C’est une dépendance assumée, civilisée. Être totalement indépendant n’est ni possible ni souhaitable. Accepter notre dépendance à autrui, c’est reconnaître notre humanité.
Et plus nous dépendons des autres dans une structure symbolique saine, plus nous pouvons jouir pleinement de la vie.
POUR EN SAVOIR PLUS:
https://amzn.eu/d/iLZ0FSf

