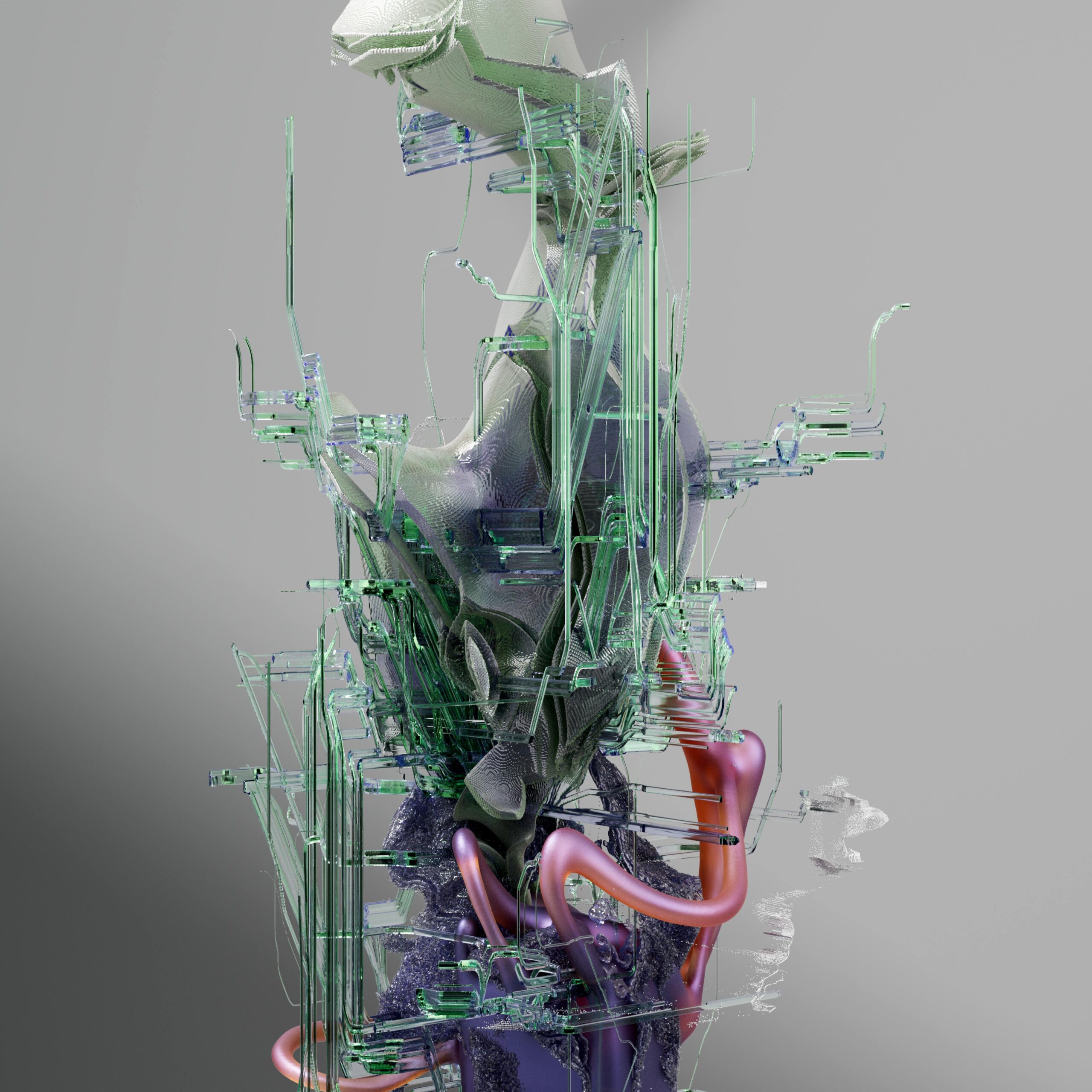
Il existe un moment essentiel dans le développement de tout être humain, où l’enfant ne distingue pas encore son propre corps de celui de sa mère.
Dans cet état initial, il n’y a pas deux êtres, mais un seul. L’enfant vit dans une forme de continuité fusionnelle avec le corps maternel ; l’autre n’est perçu que comme une extension de lui-même.
Mais cette fusion ne peut durer éternellement. Un tiers apparaît. Pour certains, c’est le père ; pour d’autres, cela peut être n’importe quelle présence, objet ou désir qui interrompt ce lien exclusif avec la mère. Ce tiers révèle à l’enfant que la mère désire quelque chose — ou quelqu’un — d’autre que lui.
Et cette révélation est décisive : elle lui montre qu’il n’est pas tout pour elle.
C’est à ce moment-là que l’enfant commence à percevoir la différence, la séparation. Pour comprendre que lui et la mère sont deux, il faut qu’il y ait un troisième. La présence d’un autre corps, d’un autre regard, d’un autre désir, force l’enfant à se diviser, à renoncer à cette unité première. Cette scission donne naissance au moi, à la conscience, reléguant le lien fusionnel avec la mère dans l’inconscient.
Ce passage — douloureux, mais nécessaire — est ce que de nombreux théoriciens ont décrit comme une dissociation du moi. Freud l’a nommé le complexe d’Œdipe. Mais l’Œdipe ne doit pas être compris seulement comme une affaire de relation entre l’enfant, la mère et le père. Il s’agit de quelque chose de plus profond : un passage symbolique par lequel l’être humain cesse d’être un simple animal pour devenir un sujet.
L’Œdipe n’est pas uniquement un conflit familial. Il représente le moment fondateur où l’enfant rencontre, pour la première fois, le symbole. C’est son entrée dans un monde régi par la loi, le langage et le désir de l’Autre. Et c’est dans cette perte, dans ce renoncement, que naît l’humanité du sujet.

